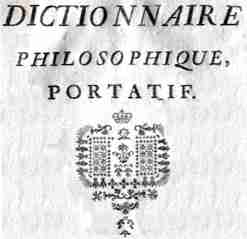Wir geben hier den Artikel Idole, Idolâtre, Idolâtrie – Götzenbild, Götzendiener aus der ersten Ausgabe des Philosophischen Wörterbuchs von 1764 in französischer Sprache wieder.
Idole, vient du grec eidos, figure; eidolos, représentation d’une figure, latreuein, servir, révérer, adorer. Ce mot adorer est latin et a beaucoup d’acceptions différentes: il signifie porter la main à la bouche en parlant avec respect, se courber, se mettre à genoux, saluer, et enfin communément, rendre un culte suprême.
Il est utile de remarquer ici que le Dictionnaire de Trévoux commence cet article par dire que tous les païens étaient idolâtres, et que les Indiens sont encore des peuples idolâtres. Premièrement, on n’appela personne païen avant Théodose le Jeune. Ce nom fut donné alors aux habitants des bourgs d’Italie, pagorum incolae, pagani, qui conservèrent leur ancienne religion. Secondement, l’Indoustan est mahométan; et les mahométans sont les implacables ennemis des images et de l’idolâtrie. Troisièmement, on ne doit point appeler idolâtres beaucoup de peuples de l’Inde qui sont de l’ancienne religion des Parsis, ni certaines castes qui n’ont point d’idole.
E X A M E N
Y a-t-il jamais eu un gouvernement idolâtre?
Il paraît que jamais il n’y a eu aucun peuple sur la terre qui ait pris ce nom d’idolâtre. Ce mot est une injure, un terme outrageant, tel que celui de gavache que les Espagnols donnaient autrefois aux Français, et celui de maranes que les Français donnaient aux Espagnols, si on avait demandé au sénat de Rome, à l’aréopage d’Athènes, à la cour des rois de Perses: Êtes-vous idolâtres? ils auraient à peine entendu cette question. Nul n’aurait répondu: « Nous adorons des images, des idoles. » On ne trouve ce mot idolâtre, idolâtrie, ni dans Homère, ni dans Hésiode, ni dans Hérodote, ni dans aucun auteur de la religion des gentils. Il n’y a jamais eu aucun édit, aucune loi qui ordonnât qu’on adorât des idoles, qu’on les servît en dieux, qu’on les regardât comme des Dieux.
Quand les capitaines romains et carthaginois faisaient un traité, ils attestaient tous leurs dieux, « C’est en leur présence, disaient-ils, que nous jurons la paix. » Or, les statues de tous ces dieux, dont le dénombrement était très long, n’étaient pas dans la tente des généraux. Ils regardaient ou feignaient les dieux comme présents aux actions des hommes, comme témoins, comme juges. Et ce n’est pas assurément le simulacre qui constituait la divinité.
De quel oeil voyaient-ils donc les statues de leurs fausses divinités dans les temples? du même oeil, s’il est permis de s’exprimer ainsi, que les catholiques voient les images, objets de leur vénération. L’erreur n’était pas d’adorer un morceau de bois ou de marbre, mais d’adorer une fausse divinité représentée par ce bois et ce marbre. La différence entre eux et les catholiques n’est pas qu’ils eussent des images et que les catholiques n’en aient point; la différence est que leurs images figuraient des êtres fantastiques dans une religion fausse, et que les images chrétiennes figurent des êtres réels dans une religion véritable. Les Grecs avaient la statue d’Hercule, et nous celle de saint Christophe; ils avaient Esculape et sa chèvre, et nous saint Roch et son chien; ils avaient Mars et sa lance, et nous St. Antoine de Padoue et St. Jacques de Compostela.
Quand le consul Pline adresse les prières aux Dieux immortels, dans l’exorde du panégyrique de Trajan, ce n’est pas à des images qu’il les adresse. Ces images n’étaient pas immortelles.
Ni les derniers temps du paganisme; ni les plus reculés, n’offrent un seul fait qui puisse faire conclure qu’on adorât une idole. Homère ne parle que des dieux qui habitent le haut Olympe. Le palladium, quoique tombé du ciel, n’était qu’un gage sacré de la protection de Pallas; c’était elle qu’on vénérait dans le palladium: c’était notre sainte ampoule
Mais les Romains et les Grecs se mettaient à genoux devant des statues, leur donnaient des couronnes, de l’encens, des fleurs, les promenaient en triomphe dans les places publiques. Les catholiques ont sanctifié ces coutumes, et ne se disent point idolâtres.
Les femmes, en temps de sécheresse, portaient les statues des dieux après avoir jeûné. Elles marchaient pieds nus, les cheveux épars; et aussitôt il pleuvait à seaux, comme dit Pétrone: Statim urceatim pluebat. N’a-t-on pas consacré cet usage, illégitime chez les gentils, et légitime parmi les catholiques? Dans combien de villes ne porte-t-on pas nu-pieds des charognes pour obtenir les bénédictions du ciel par leur intercession? Si un Turc, un lettré chinois était témoin de ces cérémonies, il pourrait par ignorance accuser les Italiens de mettre leur confiance dans les simulacres qu’ils promènent ainsi en procession, mais il suffirait d’un mot pour le détromper.
On est surpris du nombre prodigieux de déclamations débitées dans tous les temps contre l’idolâtrie des Romains et des Grecs; et ensuite on est plus surpris encore quand on voit qu’ils n’étaient pas idolâtres.
Il y avait des temples plus privilégiés que les autres. La grande Diane d’Éphèse avait plus de réputation qu’une Diane de village. Il se faisait plus de miracles dans le temple d’Esculape à Épidaure que dans un autre de ses temples. La statue de Jupiter Olympien attirait plus d’offrandes que celle de Jupiter Paphlagonien. Mais puisqu’il faut toujours opposer ici les coutumes d’une religion vraie à celle d’une religion fausse, n’avons-nous pas eu depuis plusieurs siècles plus de dévotion à certains autels qu’à d’autres?
Ne portons-nous pas plus d’offrandes à Notre-Dame de Lorette qu‘à Notre-Dame des Neiges? C’est à nous à voir si on doit saisir ce prétexte pour nous accuser d’idolâtrie?
Il en était absolument de même chez les païens: on n’avait imaginé qu’une seule divinité, un seul Apollon, et non pas autant d’Apollons et de Dianes qu’ils avaient de temples et de statues. Il est donc prouvé, autant qu’un point d’histoire peut l’être, que les anciens ne croyaient pas qu’une statue fut une divinité, que le culte ne pouvait être rapporté à cette statue, à cette idole et par conséquent les anciens n’étaient point idolâtres. C’est à nous à voir si on doit saisir ce prétexte pour nous accuser d’idolâtrie.
On n’avait imaginé qu’une seule Diane, un seul Apollon, un seul Esculape, non pas autant d’Apollons, de Dianes et d’Esculapes qu’ils avaient de temples et de statues. Il est donc prouvé, autant qu’un point d’histoire peut l’être. Que les anciens ne croyaient pas que une statue fût une divinité, que le culte ne pouvait être rapporté à cette statue, à cette idole, et que par conséquent les anciens n’étaient pas idolâtres.
Une populace grossière et superstitieuse qui ne raisonnait point, qui ne savait ni douter ni nier, ni croire, qui courait au temple par oisiveté, et parce que les petits y sont égaux aux grands, qui portait son offrande par coutume, qui parlait continuellement de miracles sans en avoir examiné aucun, et qui n’était guère au-dessus des victimes qu’elle amenait; cette populace, dis-je, pouvait bien, à la vue de la grande Diane et de Jupiter tonnant, être frappée d’une horreur religieuse, et adorer, sans le savoir, la statue même; c’est ce qui est arrivé quelquefois dans nos temples à nos paysans grossiers; et on n’a pas manqué de les instruire que c’est aux bienheureux, aux mortels reçus dans le ciel qu’ils doivent demander leur intercession, et non à des figures de bois et de Pierre et qu’ils ne doivent adorer que Dieu seul.
Les Grecs et les Romains augmentèrent le nombre de leurs dieux par leurs apothéoses. Les Grecs divinisaient les conquérants, comme Bacchus, Hercule, Persée. Rome dressa des autels à ses empereurs. Nos apothéoses sont d’un genre différent. Nous avons des Saints au lieu de leurs demi-Dieux, de leurs Dieux secondaires, mais nous n’avons égard ni au rang ni aux conquêtes. Nous avons élevé des temples à des hommes simplement vertueux, qui seraient ignorés sur la terre s’ils n’étaient placés dans le ciel. Les apothéoses des anciens sont faites par la flatterie, les nôtres par le respect pour la vertu. Mais ces anciennes apothéoses sont encore une preuve convaincante que les Grecs et les Romains n’étaient point proprement idolâtres. Il est clair qu’ils n’admettaient plus une vertu divine à la statue d’Auguste et de Claudius, que dans leurs médailles.
Cicéron, dans ses ouvrages philosophiques, ne laisse pas soupçonner seulement qu’on puisse se méprendre aux statues des dieux, et les confondre avec les dieux mêmes. Ses interlocuteurs foudroient la religion établie; mais aucun d’eux n’imagine d’accuser les Romains de prendre du marbre et de l’airain pour des divinités. Lucrèce ne reproche cette sottise à personne, lui qui reproche tout aux superstitieux. Donc, encore une fois, cette opinion n’existait pas, on n’en avait aucune idée; il n’y avait point d’idolâtres.
Horace fait parler une statue de Priape, il lui fait dire: J’étais autrefois un tronc de figuier; un charpentier, ne sachant s’il ferait de moi un dieu ou un banc, se détermina enfin a me faire Dieu. Que conclure de cette plaisanterie? Priape était de ces divinités subalternes, abandonnées aux railleurs; et cette plaisanterie même est la preuve la plus forte que cette figure de Priape, qu’on mettait dans les potagers pour effrayer les oiseaux, n’était pas fort révérée.
Dacier, en se livrant à l’esprit commentateur, n’a pas manqué d’observer que Baruch avait prédit cette aventure, en disant: Ils ne seront que ce que voudront les ouvriers; mais il pouvait observer aussi qu’on en peut dire autant de toutes les statues.
On peut d’un bloc de marbre tirer tout aussi bien une cuvette qu’une figure d’Alexandre ou de Jupiter, ou de quelque autre chose plus respectable. La matière dont étaient formés les chérubins du Saint des saints aurait pu servir également aux fonctions les plus viles. Un trône, un autel, en sont-ils moins révérés parce que l’ouvrier en pouvait faire une table de cuisine?
Dacier, au lieu de conclure que les Romains adoraient la statue de Priape, et que Baruch l’avait prédit, devait donc conclure que les Romains s’en moquaient. Consultez tous les auteurs qui parlent des statues de leurs dieux, vous n’en trouverez aucun qui parle d’idolâtrie; ils disent expressément le contraire. Vous voyez dans:
Qui finxit sacros auro vel marmore vultus,
Non facit ille deos;
Dans Ovide:
Colitur pro Jove forma Jovis.
Dans Stace:
Nulla autem effigies, nulli commissa metallo.
Forma Dei; mentes habitare ac numina gaudet.
Dans Lucain:
Estne Dei sedes, nisi terra et pontus et aer?
On ferait un volume de tous les passages qui déposent que des images n’étaient que des images.
Il n’y a que le cas où les statues rendaient des oracles qui ait pu faire penser que ces statues avaient en elles quelque chose de divin. Mais certainement l’opinion régnante était que les dieux avaient choisi certains autels, certains simulacres pour y venir résider quelquefois, pour y donner audience aux hommes, pour leur répondre. On ne voit dans Homère et dans les choeurs des tragédies grecques que des prières à Apollon qui rend ses oracles sur les montagnes, en tel temple, en telle ville; il n’y a pas dans toute l’antiquité la moindre trace d’une prière adressée à une statue; si on croyait que l’esprit divin préférait quelques temples, quelques images, comme on croyait aussi qu’il préférait quelques hommes, la chose était certainement possible; ce n’était qu’une erreur de fait. Combien avons-nous d’images miraculeuses! Les anciens se vantaient d’avoir ce que nous possédons en effet; et si nous ne sommes point idolâtres, de quel droit dirons-nous qu’ils l’ont été?
Ceux qui professaient la magie, qui la croyaient une science, ou qui feignaient de le croire, prétendaient avoir le secret de faire descendre les dieux dans les statues; non pas les grands dieux, mais les dieux secondaires, les génies. C’est ce que Mercure Trimégiste appelait faire des dieux; et c’est ce que saint Augustin réfute dans sa Cité de Dieu. Mais cela même montre évidemment que les simulacres n’avaient rien en eux de divin, puisqu’il fallait qu’un magicien les animât; et il me semble qu’il arrivait bien rarement qu’un magicien fût assez habile pour donner une âme à une statue, pour la faire parler.
En un mot, les images des dieux n’étaient point des dieux. Jupiter, et non pas son image, lançait le tonnerre; ce n’était pas la statue de Neptune qui soulevait les mers, ni celle d’Apollon qui donnait la lumière. Les Grecs et les Romains étaient des gentils, des polythéistes, et n’étaient point des idolâtres.
Si les Perses, les Sabéens, les Égyptiens, les Tartares, les Turcs, ont été idolâtres; et de quelle antiquité est l’origine des simulacres appelés idoles. Histoire de leur culte.
C’est une grande erreur d’appeler idolâtres les peuples qui rendirent un culte au soleil et aux étoiles. Ces nations n’eurent longtemps ni simulacres ni temples. Si elles se trompèrent, c’est en rendant aux astres ce qu’elles devaient au créateur des astres. Encore le dogme de Zoroastre ou Zerdust, recueilli dans le Sadder, enseigne-t-il un Être suprême, vengeur et rémunérateur; et cela est bien loin de l’idolâtrie. Le gouvernement de la Chine n’a jamais eu aucune idole; il a toujours conservé le culte simple du maître du ciel Kingtien.
Gengis-kan chez les Tartares n’était point idolâtre, et n’avait aucun simulacre. Les musulmans, qui remplissent la Grèce, l’Asie-Mineure, la Syrie, la Perse, l’Inde et l’Afrique, appellent les chrétiens idolâtres, giaours, parce qu’ils croient que les chrétiens rendent un culte aux images. Ils brisèrent plusieurs statues qu’ils trouvèrent à Constantinople, dans Sainte-Sophie et dans l’église des Saints-Apôtres et dans d’autres, qu’ils convertirent en mosquées. L’apparence les trompa comme elle trompe toujours les hommes, et leur fit croire que des temples dédiés à des saints qui avaient été hommes autrefois, des images de ces saints révérées à genoux, des miracles opérés dans ces temples, étaient des preuves invincibles de l’idolâtrie la plus complète; cependant il n’en est rien. Les chrétiens n’adorent en effet qu’un seul Dieu, et ne révèrent dans les bienheureux que la vertu même de Dieu, qui gît dans ses saints. Les iconoclastes et les protestants ont fait le même reproche d’idolâtrie à l’Église, et on leur a fait la même réponse.
Comme les hommes ont eu très rarement des idées précises. et ont encore moins exprimé leurs idées par des mots précis et sans équivoque, nous appelâmes du nom d’idolâtres les gentils et surtout les polythéistes. On a écrit des volumes immenses, on a débité des sentiments divers sur l’origine de ce culte rendu à Dieu ou à plusieurs dieux sous des figures sensibles: cette multitude de livres et d’opinions ne prouve que l’ignorance.
On ne sait pas qui inventa les habits et les chaussures, et on veut savoir qui le premier inventa les idoles! Qu’importe un passage de Sanchoniaton, qui vivait avant la guerre de Troye? que nous apprend-il, quand il dit que le chaos, l’esprit, c’est-à-dire le souffle, amoureux de ses principes. en tira le limon, qu’il rendit l’air lumineux, que le vent Colp et sa femme Baü engendrèrent Eon, qu’Eon engendra Genos, que Cronos, leur descendant, avait deux yeux par derrière comme par devant, qu’il devint dieu, et qu’il donna l’Égypte à son fils Taut? voilà un des plus respectables monuments de l’antiquité.
Orphée ne nous en apprendra pas davantage dans sa Théogonie, que Damascius nous a conservée. Il représente le principe du monde sous la figure d’un dragon à deux têtes, l’une de taureau, l’autre de lion, un visage au milieu, qu’il appelle visage-dieu, et des ailes dorées aux épaules.
Mais vous pouvez de ces idées bizarres tirer deux grandes vérités: l’une, que les images sensibles et les hiéroglyphes sont de l’antiquité la plus haute; l’autre, que tous les anciens philosophes ont reconnu un premier principe.
Quant au polythéisme, le bon sens vous dira que dès qu’il y a eu des hommes, c’est-à-dire des animaux faibles, capables de raison et de folie, sujets à tous les accidents, à la maladie et à la mort, ces hommes ont senti leur faiblesse et leur dépendance; ils ont reconnu aisément qu’il est quelque chose de plus puissant qu’eux; ils ont senti une force dans la terre, qui fournit leurs aliments; une dans l’air, qui souvent les détruit; une dans le feu, qui consume; et dans l’eau, qui submerge. Quoi de plus naturel dans des hommes ignorants que d’imaginer des êtres qui présidaient à ces éléments? quoi de plus naturel que de révérer la force invisible qui faisait luire aux yeux le soleil et les étoiles? et dès qu’on voulut se former une idée de ces puissances supérieures à l’homme, quoi de plus naturel encore que de les figurer d’une manière sensible? Pouvait-on s’y prendre autrement? La religion juive, qui précéda la nôtre, et qui fut donnée par Dieu même, était toute remplie de ces images sous lesquelles Dieu est représenté. Il daigne parler dans un buisson le langage humain; il paraît sur une montagne: les esprits célestes qu’il envoie viennent tous avec une forme humaine; enfin le sanctuaire est couvert de chérubins, qui sont des corps d’hommes avec des ailes et des têtes d’animaux. C’est ce qui a donné lieu à l’erreur de Plutarque, de Tacite d’Appien et de tant d’autres, de reprocher aux Juifs d’adorer une tête d’âne. Dieu, malgré sa défense de peindre et de sculpter aucune figure, a donc daigné se proportionner à la faiblesse humaine qui demandait qu’on parlât aux sens par des images.
Isaïe, dans le chapitre vi, voit le Seigneur assis sur un trône et le bas de sa robe qui remplit le temple. Le Seigneur étend sa main, et touche la bouche de Jérémie, au chapitre i de ce prophète. Ézéchiel au chapitre i voit un trône de saphir, et Dieu lui paraît comme un homme assis sur ce trône. Ces images n’altèrent point la pureté de la religion juive, qui jamais n’employa les tableaux, les statues, les idoles pour représenter Dieu aux yeux du peuple.
Les lettrés Chinois, les Parsis, les anciens Égyptiens, n’eurent point d’idoles; mais bientôt Isis et Osiris furent figurés; bientôt Bel à Babylone, fut un gros colosse; Brama fut un monstre bizarre dans la presqu’île de l’Inde. Les Grecs surtout multiplièrent les noms des dieux, les statues et les temples, mais en attribuant toujours la suprême puissance à leur Zeus, nommé par les Latins Jupiter, maître des dieux et des hommes. Les Romains imitèrent les Grecs. Ces peuples placèrent toujours tous les dieux dans le ciel, sans savoir ce qu’ils entendaient par le ciel.
Les Romains eurent leurs douze grands dieux, six mâles et six femelles, qu’ils nommèrent Dii majorum gentium: Jupiter, Neptune, Apollon, Vulcain, Mars, Mercure, Junon, Vesta, Minerve, Cérès, Vénus, Diane. Pluton fut oublié; Vesta prit sa place.
Ensuite venaient les dieux minorum gentium, les dieux indigètes, les héros, comme Bacchus, Hercule, Esculape; les dieux infernaux Pluton, Proserpine; ceux de la mer, comme Thétis, Amphitrite, les Néréides, Glaucus: puis les Dryades, les Naïades, les dieux des jardins, ceux des bergers: il y en avait pour chaque profession, pour chaque action de la vie, pour les enfants, pour les filles nubiles, pour les mariées, pour les accouchées; on eut le dieu Pet. On divinisa enfin les empereurs. Ni ces empereurs, ni le dieu Pet, ni la déesse Pertunda, ni Rumilia, la déesse des têtons, ni Stercutius, le dieu de la garde-robe, ne furent à la vérité regardés comme les maîtres du ciel et de la terre. Les empereurs eurent quelquefois des temples, les petit dieux pénates n’en eurent point; mais tous eurent leur figure, leur idole.
C’étaient de petits magots dont on ornait son cabinet; c’étaient les amusements des vieilles femmes et des enfants, qui n’étaient autorisés par aucun culte public. On laissait agir à son gré la superstition de chaque particulier. On retrouve encore ces petites idoles dans les ruines des anciennes villes.
Si personne ne sait quand les hommes commencèrent à se faire des idoles, on sait qu’elles sont de l’antiquité la plus haute. Tharé, père d’Abraham, en faisait à Ur en Chaldée. Rachel déroba et emporta les idoles de son beau-père Laban. On ne peut remonter plus haut.
Mais quelle notion précise avaient les anciennes nations de tous ces simulacres? Quelle vertu, quelle puissance leur attribuait-on? Croyait-on que les dieux descendaient du ciel pour venir se cacher dans ces statues, ou qu’ils leur communiquaient une partie de l’esprit divin, ou qu’ils ne leur communiquaient rien du tout? C’est encore sur quoi on a très inutilement écrit; il est clair que chaque homme en jugeait selon le degré de sa raison, ou de sa crédulité, ou de son fanatisme. Il est évident que les prêtres attachaient le plus de divinité qu’ils pouvaient à leurs statues, pour s’attirer plus d’offrandes. On sait que les philosophes réprouvaient ces superstitions, que les guerriers s’en moquaient, que les magistrats les toléraient, et que le peuple toujours absurde, ne savait ce qu’il faisait. C’est, en peu de mots, l’histoire de toutes les nations à qui Dieu ne s’est pas fait connaître.
On peut se faire la même idée du culte que toute l’Égypte rendit à un boeuf, et que plusieurs villes rendirent à un chien, à un singe, à un chat, à des oignons. Il y a grande apparence que ce furent d’abord des emblèmes. Ensuite un certain boeuf Apis, un certain chien nommé Anubis, furent adorés; on mangea toujours du boeuf et des oignons: mais il est difficile de savoir ce que pensaient les vieilles femmes d’Égypte des oignons sacrés et des boeufs.
Les idoles parlaient assez souvent. On faisait commémoration à Rome, le jour de la fête de Cybèle, des belles paroles que la statue avait prononcées lorsqu’on en fit la translation du palais du roi Attale:
Ipsa pati volui; ne sit mora, mitte volentem:
Dignus Roma locus quo deus omnis eat.
“J’ai voulu qu’on m’enlevât, emmenez-moi vite: Rome est digne que tout dieu s’y établisse.” La statue de la Fortune avait parlé: les Scipion, les Cicéron, les César, à la vérité, n’en croyaient rien; mais la vieille à qui Encolpe donna un écu pour acheter des oies et des dieux(57) pouvait fort bien le croire.
Les idoles rendaient aussi des oracles, et les prêtres, cachés dans le creux des statues, parlaient au nom de la divinité.
Comment, au milieu de tant de dieux et de tant de théogonies différentes, et de cultes particuliers, n’y eut-il jamais de guerre de religion chez les peuples nommés idolâtres? Cette paix fut un bien qui naquit d’un mal, de l’erreur même; car chaque nation, reconnaissant plusieurs dieux inférieurs, trouva bon que ses voisins eussent aussi les leurs. Si vous exceptez Cambyse, à qui on reprocha d’avoir tué le boeuf Apis, on ne voit dans l’histoire profane aucun conquérant qui ait maltraité les dieux d’un peuple vaincu. Les gentils n’avaient aucune religion exclusive, et les prêtres ne songèrent qu’à multiplier les offrandes et les sacrifices.
Les premières offrandes furent des fruits. Bientôt après il fallut des animaux pour la table des prêtres; il les égorgeaient eux-mêmes; ils devinrent bouchers et cruels: enfin ils introduisirent l’usage horrible de sacrifier des victimes humaines, et surtout des enfants et des jeunes filles. Jamais les Chinois, ni les Parsis, ni les Indiens, ne furent coupables de ces abominations; mais à Hiéropolis en Égypte, au rapport de Porphyre, on immola des hommes.
Dans la Tauride on sacrifiait des étrangers; heureusement les prêtres de la Tauride ne devaient pas avoir beaucoup de pratiques. Les premiers Grecs, les Cypriots, les Phéniciens, les Tyriens, les Carthaginois, eurent cette superstition abominable. Les Romains eux-mêmes tombèrent dans ce crime de religion; et Plutarque rapporte qu’ils immolèrent deux Grecs et deux Gaulois pour expier les galanteries de trois vestales. Procope, contemporain du roi des Francs Théodebert, dit que les Francs immolèrent des hommes quand ils entrèrent en Italie avec ce prince. Les Gaulois, les Germains, faisaient communément de ces affreux sacrifices. On ne peut guère lire l’histoire sans concevoir de l’horreur pour le genre humain.
Il est vrai que, chez les Juifs, Jephté sacrifia sa fille, et que Saül fut prêt d’immoler son fils; il est vrai que ceux qui étaient voués au Seigneur par anathème ne pouvaient être rachetés ainsi qu’on rachetait les bêtes, et qu’il fallait qu’ils périssent. Samuel prêtre Juif hacha en morceaux avec un saint couperet le roi Agag prisonnier de guerre et qui Saul avait pardonner, et Saul fut réprouvé pour avoir observe le droit des gens avec ce roi. Mais Dieu maître des homes, peut leur ôter la vie quand il veut, comme il le veut, et par qui il veut; et ce n’est pas aux homes à se metre à la place du maître de la vie et de la mort, et à usurper les droits de l’Être suprême.
Pour consoler le genre humain de cet horrible tableau, de ces pieux sacrilèges, il est important de savoir que, chez presque toutes les nations nommées idolâtres, il y avait la théologie sacrée et l’erreur populaire, le culte secret et les cérémonies publiques, la religion des sages et celle du vulgaire. On n’enseignait qu’un seul Dieu aux initiés dans les mystères: il n’y a qu’à jeter les yeux sur l’hymne attribué à l’ancien Orphée, qu’on chantait dans les mystères de Cérès Éleusine, si célèbre en Europe et en Asie. “Contemple la nature divine, illumine ton esprit, gouverne ton coeur, marche dans la voie de la justice, que le Dieu du ciel et de la terre soit toujours présent à tes yeux; il est unique, il existe seul par lui-même, tous les êtres tiennent de lui leur existence; il les soutient tous: il n’a jamais été vu des mortels, et il voit toutes choses.”
Qu’on lise encore ce passage du philosophe Maxime de Madaure, dans sa lettre à St. Augustin: “Quel homme est assez grossier, assez stupide pour douter qu’il soit un Dieu suprême, éternel, infini, qui n’a rien engendré de semblable à lui-même, et qui est le père commun de toutes choses?”
Il y a mille témoignages que les sages abhorraient non seulement l’idolâtrie, mais encore le polythéisme.
Épictète, ce modèle de résignation et de patience, cet homme si grand dans une condition si basse, ne parle jamais que d’un seul Dieu. Relisez encore cette maxime: „Dieu m’a créé, Dieu est au dedans de moi; je le porte partout. Pourrais-je le souiller par des pensées obscènes, par des actions injustes, par d’infâmes désirs? Mon devoir est de remercier Dieu de tout, de le louer de tout, et de ne cesser de le bénir qu’en cessant de vivre.“ Toutes les idées d’Épictète roulent sur ce principe.
Marc-Aurèle, aussi grand peut-être sur le trône de l’empire romain qu’Épictète dans l’esclavage, parle souvent, à la vérité, des dieux, soit pour se conformer au langage reçu, soit pour exprimer des êtres mitoyens entre l’Être suprême et les hommes: mais en combien d’endroits ne fait-il pas voir qu’il ne reconnaît qu’un Dieu éternel, infini! “Notre âme, dit-il, est une émanation de la Divinité. Mes enfants, mon corps, mes esprits, me viennent de Dieu.”
Les stoïciens, les platoniciens, admettaient une nature divine et universelle; les épicuriens la niaient. Les pontifes ne parlaient que d’un seul Dieu dans les mystères. Où étaient donc les idolâtres? Tous nos déclamateurs crient à l’idolâtrie comme de petits chiens qui jappent quand ils entendent un gros chien aboyer.
Au reste, c’est une des plus grandes erreurs du Dictionnaire de Moréri, de dire que du temps de Théodose le Jeune il ne resta plus d’idolâtres que dans les pays reculés de l’Asie et de l’Afrique. Il y avait dans l’Italie beaucoup de peuples encore gentils, même au septième siècle. Le nord de l’Allemagne, depuis le Vézer, n’était pas chrétien du temps de Charlemagne. La Pologne et tout le Septentrion restèrent longtemps après lui dans ce qu’on appelle idolâtrie. La moitié de l’Afrique, tous les royaumes au delà du Gange, le Japon, la populace de la Chine, cent hordes de Tartares, ont conservé leur ancien culte. Il n’y a plus en Europe que quelques Lapons, quelques Samoyèdes, quelques Tartares, qui aient persévéré dans la religion de leurs ancêtres.
Finissons par remarquer que, dans les temps qu’on appelle parmi nous le moyen-âge, nous appelions le pays des mahométans la Paganie; nous traitions d’idolâtres, d’adorateurs d’images, un peuple qui a les images en horreur. Avouons, encore une fois, que les Turcs sont plus excusables de nous croire idolâtres, quand ils voient nos autels chargés d’images et de statues.